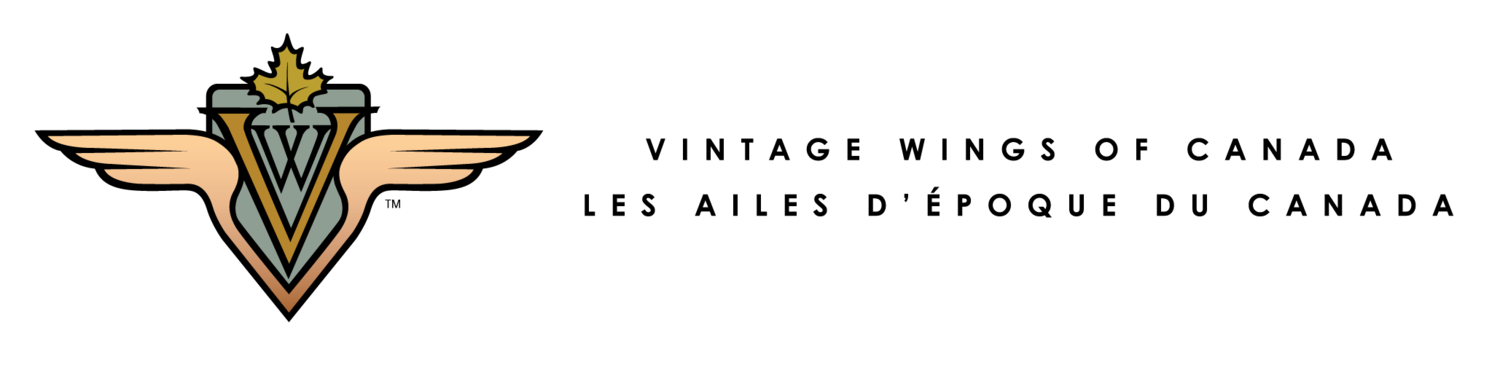Il tombe de sept milles pieds
Il y a 72 ans, dans la nuit du 16 au 17 janvier 1943, le sergent de section Andrew Carswell, âgé de 20 ans, éprouvait des sérieux ennuis. Il était le pilote et le commandant de l’Avro Lancaster WS-A (numéro de série RAF W4379) du 9e Escadron. Aux environs de la ville de Magdeburg, en Allemagne, alors qu’il revenait de bombarder une cible fortement défendue à Berlin, il a été touché par une DCA nourrie et précise. Son moteur tribord était en feu et l’avion plongeait en piqué incontrôlable avec ses réservoirs de carburant au point d’exploser. C’était seulement sa quatrième mission. Cette nuit mettra fin à sa guerre aérienne, mais pas à sa lutte ni à sa longue carrière de pilote. Les mémoires de Carswell, intitulées Over the Wire sont composés de récits de survie, d’évasion, d’emprisonnement et de fuites les plus saisissantes que j’aie jamais lues. Ces mémoires sont plus étranges et plus merveilleux que la fiction. Au 72e anniversaire de son évasion de son bombardier condamné, son éditeur a accepté, pour votre plaisir, de nous permettre de publier le premier chapitre de son livre « Seven Thousand Feet and Falling ». Le reste de l’ouvrage n’est pas moins passionnant et constitue l’un des meilleurs mémoires de guerre que l’on puisse trouver, bien que son tirage soit très limité. John, le fils de Carswell, a fait don de 300 de ses livres aux Ailes d’époque du Canada et de 300 autres au Canadian Warplane Heritage Museum (CWHM), qui exploite l’un des deux seuls Lancaster encore en état de vol dans le monde. À la fin de cette histoire, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez commander ce livre rare directement auprès du CWHM. Les profits des ventes seront partagés par ces deux organisations qui se consacrent à perpétuer le souvenir de nos grands héros de l’aviation de la Seconde Guerre mondiale. - Dave O’Malley, Vintage News
Voici Tomber de sept milles pieds (Seven Thousand Feet and Falling):
Je n’ai pas eu la sensation de tomber. J’avais plutôt l’impression de flotter immobile dans l’espace avec le cri aigu des moteurs Rolls-Royce Merlin qui s’éteignait rapidement dans l’obscurité froide de la nuit en arrière-plan.
Soudain, un léger bruit sec a interrompu mon état de rêve, il y a eu un bruissement comme un drapeau dans le vent, et j’ai été projeté tout droit vers les étoiles à 120 miles à l’heure alors qu’au même moment le harnais du parachute coupait, d’un coup sec douloureux, mon entrejambe. Le cri faiblissant des moteurs au loin s’est arrêté. Il y a eu une déflagration sourde. Puis, à l’exception du bruit de mon parachute, un silence de mort.
Par contraste avec la noirceur du ciel, les étoiles étaient si brillantes que j’avais l’impression de pouvoir les toucher du bout des doigts. Il faisait un froid mortel - vingt ou trente degrés sous zéro en Fahrenheit. J’étais là, un adolescent âgé de dix-neuf ans, à peine sorti de l’école secondaire, à des milliers de pieds dans les airs, suspendu à un parachute non loin de Berlin, flottant au beau milieu du territoire ennemi.
À un mile environ en dessous de moi, il y avait des bois sombres, des champs éclairés par la lune, et une rivière argentée. Tout était immobile, silencieux. Je me sentais très seul. Quelques secondes auparavant, il n’y avait eu que du bruit : le rugissement de quatre moteurs Rolls-Royce Merlin de 1250 chevaux à plus de trois mille tours minute cherchant à se désintégrer; les déflagrations sourdes des obus anti-aériens qui nous entouraient; le sifflement de l’air qui s’échappe lorsque Paddy Hipson, notre bombardier, active le système de largage d’urgence de la trappe d’évacuation, la faisant exploser vers l’obscurité hurlante. Les flammes du moteur numéro trois, qui dévoraient le bord d’attaque de l’aile, étaient éblouissantes. À quelques centimètres seulement des réservoirs de carburant principaux, elles menaçaient dangereusement leurs milliers de gallons d’essence à haut indice d’octane.
Je venais de plonger par la trappe d’évacuation avant d’un bombardier Lancaster en feu. Je fonçais vers le sol à plus de trois cents milles à l’heure, avec un parachute accroché à mon harnais par deux crochets plutôt fragiles, et ma main droite fermement agrippée à l’anneau D de la commande manuelle d’ouverture du parachute. Étant gaucher, j’avais entendu de nombreuses histoires de gauchers qui avaient paniqué dans de telles situations et qui s’étaient écrasés au sol essayant frénétiquement avec leur main gauche de s’agripper à un anneau D inexistant. J’avais aussi entendu des histoires de gauchers qui avaient paniqué et tiré l’anneau D trop tôt, remplissant la cabine de soie de parachute bloquant ainsi leur sortie. C’était ma quatrième mission opérationnelle au-dessus du territoire ennemi, avec seulement quelques centaines d’heures d’expérience de vol. J’étais capitaine d’un bombardier quadrimoteur avec un équipage de sept personnes, et j’étais le seul à bord à savoir piloter l’avion.
Un peu plus d’un an auparavant, j’avais obtenu mon diplôme de fin d’études secondaires, au lendemain de mon dix-huitième anniversaire. C’était l’été 1941. Bien que trop jeune pour boire légalement de la bière j’avais atteint l’âge pour m’enrôler. Débordant de patriotisme nourri par la propagande de l’époque comme la plupart des jeunes gens, je me suis enrôlé dans l’ARC - l’Aviation royale du Canada.
J’avais récemment vu James Cagney dans « Captains of the Clouds ». Il s’agit d’un film hollywoodien avec comme vedette un pilote de brousse yankee tape-à-l’œil qui s’engage dans l’ARC comme pilote et qui gagne la guerre presque à lui seul. C’est alors que j’ai décidé que je serais pilote.
Par pure chance, j’ai été choisi comme élève-pilote. Mes notes en mathématiques n’étaient pas assez bonnes pour devenir navigateur. Comme j’étais en très bonne santé et aussi très rapide, car j’avais été entraîné à la course en me sauvant de la brute de l’école, j’ai donc facilement réussi les tests physiques.
À cette époque, selon la procédure normale, on intégrait l’aviation en tant que candidat potentiel comme personnel navigant. Ensuite nous devions attendre notre tour pour la sélection et la formation. Cela prenait des mois, et parfois des années. On vous donnait un uniforme bleu de l’ARC avec un petit insigne blanc dans le calot, pour signifier que vous étiez stagiaire. Par après, on vous bourrait de vaccins et de sérums. Pour clore l’épreuve, habillé d’un lourd uniforme de laine, on vous faisait immédiatement parader sous le soleil brûlant jusqu’au bord de l’évanouissement. On vous apprenait à parader, à jurer et à raconter des blagues salaces par des petits hommes dégoûtants appelés des « discip. » Il s’agissait de caporaux qui jouissaient d’une autorité attribuée par le gouvernement comparable à celle de Dieu lui-même.
Avec mes collègues, nous étions dotées d’un fusil et affectées à des fonctions de garde sur un obscur aérodrome de la Saskatchewan. Tous attendaient qu’un nouveau cours soit offert à l « ’ITS » (école de formation initiale), afin que les stagiaires puissent être testés, formés et sélectionnés pour l’une des trois catégories de personnel navigant.
En 1941, de nouvelles écoles ouvraient régulièrement leurs portes. Alors que notre groupe se trouvait au dépôt de personnel de Toronto, craignant une affectation à un autre poste de veille, une nouvelle « ITS » s’est ouverte à Belleville, en Ontario. Comme par magie, notre groupe a été envoyé là-bas alors qu’un autre groupe plus méritant, ayant fait ses preuves à l’aérodrome de la Saskatchewan, aurait logiquement été le prochain à trouver sa place sur le cours.
En octobre 1941, l’aviateur principal Andrew Carswell (deuxième à gauche, troisième rangée à partir du haut) pose fièrement pour une photo de groupe de la section « G », escadron no 2, à l’École d’entraînement initial no 5 de l’Aviation royale du Canada à Belleville, Ontario, sur le lac Ontario. La date est. Photo : Archives de la famille Carswell
Le court-circuitage des procédures normales nous a beaucoup plu et naturellement, nous ne nous sommes pas plaints. Aucun d'entre nous n'a réalisé que cette voie rapide en formation pour beaucoup d'entre nous ne ferait qu’accélérer notre parcours vers l’enfer.
Après quelques mois d'entraînement au sol et de sélection à « l ITS », certains d'entre nous étaient choisis comme pilotes, d'autres comme navigateurs, et le reste comme mitrailleurs de bord. Avant la fin de la guerre, la plupart de mes camarades de classe ont perdu la vie d'une manière ou d'une autre. J’aurais péri également, je suppose, si je n’étais pas devenu victime d’une « malchance » le 17 janvier 1943.
Ma « bonne fortune » a persisté, et j’ai été sélectionné comme pilote stagiaire. Encore une autre « bonne fortune ». J’ai été affecté à l’ELP numéro 12 (école élémentaire de pilotage) à Goderich, en Ontario sur un nouveau cours pour pilotes. Je n’ai pas eu de congé, mais aussi pas d’attente non plus. Une soixantaine d’heures de vol plus tard sur un biplan appelé Fleet Finch, j’ai obtenu mon diplôme de l’école élémentaire de pilotage. Peu après, j’ai été réaffecté à l’école élémentaire de pilotage numéro 5 à Brantford, en Ontario, pour apprendre à piloter des avions bimoteurs sur le bon vieux Avro Anson. Mon destin se jouerait donc comme pilote de bombardier !
Âgé de 18 ans, à l’École élémentaire de pilotage no 12 de Goderich, en Ontario, sur le lac Huron, l’Aviateur chef Andrew Carswell rayonne de fierté auprès d’un Fleet Finch (4581). Deux ans plus tard, ce Finch sera perdu dans un accident de catégorie A à Goderich. Photo : Archives de la famille Carswell
Quelque part au-dessus du Canada au début des années 1940, des élèves de l’École élémentaire de pilotage perfectionnent leur vol en formation à bord des Fleet Finches. Photo : D’après une copie imprimée de BAC-Canada. D&D-PL 4178
Dans un hangar en compagnie d’officiers et d’un Fleet Finch, les élèves pilotes (l’insigne blanc dans le calot indique un élève du PEACB) du cours # 15 du 12 École élémentaire de pilotage sont assemblés. L’Aviateur chef Andrew Carswell est le quatrième à partir de la gauche au premier rang. C’est le jour du Souvenir, le 11 novembre 1941. Photo : J. Gordon Henderson via Huron County Museum and Historic Gaol
Un gros plan de la photo précédente révèle bien la jeunesse des élèves-pilotes dont beaucoup sont encore adolescents. Ils mettront bientôt leur vie en jeu. Andrew Carswell est au premier rang, quatrième en partant de la gauche. Photo : J. Gordon Henderson via Huron County Museum and Historic Gaol
L’école de pilotage militaire numéro 5, où Andrew Carswell a suivi son entraînement de pilotage militaire. Typique des installations d’entraînement à travers le pays, cette image révèle plusieurs détails caractéristiques standards d’une base : le camion d’intervention de secours en cas d’écrasement, la tour de contrôle et les buttes de tir en béton pour tester et aligner l’armement des avions. Photo : ARC
Lors de son deuxième vol d’entraînement « cross country », Canada, 1942. Andrew Carswell est aux commandes d’un Avro Anson à trois mille pieds d’altitude Photo : Archives de la famille Carswell
Un Avro Anson survole les rives soit du lac Ontario ou de la rivière des Outaouais. L’Anson 7150 a été affecté à l’escadron d’essai en vol et de développement de la station de l’ARC Rockcliffe, à Ottawa, et à l’établissement d’essai en vol et de développement de l’ARC Trenton, en Ontario. Photo : D’après une copie imprimée de BAC-Canada. D&D-PL 9658
Nous enviions ceux qui pilotaient des avions d’entraînement monomoteur comme le Harvard, car ils étaient destinés à devenir des pilotes de chasse. C’était une affectation prestigieuse que tous jalousaient dans l’armée de l’air. Malgré cela, je me sentais privilégié. D’autres stagiaires qui s’étaient enrôlés avec moi attendaient toujours leur formation initiale, ou avaient été remerciés de leur service par manque d’aptitude. De mon côté, j’étais sur le point d’obtenir mon brevet de pilote.
J’étais encore un jeune homme assez innocent lorsque j’ai obtenu mes ailes au cours de l’été 1942. Ce n’était pas rare à l’époque. Mon idée d’une nuit de fête en ville consistait d’inviter une fille à la pharmacie du coin ou au resto White Spot pour un lait frappé ou un Coke. L’addition montait à environ quinze cents. Le quartier Beach à Toronto où j’ai grandi était comme une petite ville à l’époque, et dans une certaine mesure, l’est toujours. La plupart d’entre nous étudiaient à la même école secondaire et traînaient ensemble sur la plage l’été. Il y avait une promenade le long du lac qui faisait exactement un mile de long, de l’avenue Beech à l’avenue Woodbine. La plupart d’entre nous pouvaient faire l’aller-retour jusqu’à Woodbine en faisant du jogging sans effort. Les couples qui se bécotaient sur les bancs du parc en face de la promenade nous ignoraient et nous de mêmes.
J’avais l’impression de flotter à plus d’un kilomètre au-dessus de la campagne éclairée. À la vitesse à laquelle je dérivais au-dessus du sol, j’en déduisais qu’un vent fort soufflait du nord-ouest. Nous avions traversé un front météorologique composé des nuages, de la turbulence et du givre, pour déboucher dans le ciel nocturne clair, froid et éclairé par la lune du nord de l’Allemagne. La température était d’environ quarante degrés sous zéro Fahrenheit à vingt-cinq mille pieds. Les fenêtres du cockpit étaient tellement givrées à l’intérieur que, lorsque les projecteurs nous ont frappés, tout ce que nous pouvions apercevoir était l’intérieur de l’avion et nos propres visages blancs et gelés. Les chaufferettes de l’avion étaient inefficaces à cette altitude, et même les combinaisons Irving; vestes, pantalons et bottes de vol doublés en peau de mouton, n’arrivaient pas à nous réchauffer - ou était-ce la peur ? Alors çà, il n’en manquait pas.
J’étais inquiet au breffage des opérations lorsque j’ai vu que Berlin était notre objectif et ça, pour la deuxième nuit consécutive. Même itinéraire, mêmes altitudes, mêmes points de virage, exactement les mêmes à tous les égards que la nuit précédente. Le raisonnement voulait que les Allemands ne croient jamais que la RAF - le Royal Air Force du Royaume-Uni - serait assez bête pour effectuer la même mission deux nuits de suite.
Après le breffage, en compagnie de mon équipage, je me suis rendu au mess pour notre petit déjeuner traditionnel composé de bacon et d’œufs. C’était un vrai régal en Grande-Bretagne en temps de guerre. Le citoyen moyen ne voyait un œuf qu’une ou deux fois par mois. L’un des capitaines expérimentés assis à la table voisine expliquait à son équipage à quel point cette mission allait être formidable. Il était capitaine d’aviation avec douze missions à son actif. Douze était considéré comme un chiffre plutôt respectable pour un escadron qui avait été décimé si souvent, car il s’agit d’un équipage des plus expérimentés. Personne n’avait terminé un tour opérationnel (trente missions) depuis un certain temps. On n’en verrait probablement pas d’autres, à moins que nous puissions trouver un moyen d’empêcher les Allemands d’abattre les membres de notre escadron en si grand nombre.
Plus les équipages étaient inexpérimentés, plus ils essayaient d’apparaître insouciants. La fanfaronnade et les plaisanteries ne faisaient que dissimuler une prise de conscience progressive qu’il y avait de fortes chances que nous allions tous mourir. Personne dans l’escadron n’avait terminé un tour opérationnel depuis longtemps, le capitaine le plus expérimenté n’ayant survécu qu’à douze voyages opérationnels.
Mais je refusais de croire que ça pourrait m’arriver. Dans les livres, les films et les récits de guerre, les «bons» survivaient toujours. Nous avons donc tous cru, ou essayé de croire que nous serions les survivants, et que les «autres» seraient les malchanceux.
Andy Carswell (à droite) et son frère Jim rendent visite à leurs parents à Ottawa pour le Noël 1941. Le père des garçons Carswell était un ingénieur électricien qui avait déménagé à Ottawa pour travailler au ministère de la Défense nationale. Andy est maintenant un sergent pilote avec son nouveau brevet de pilote tandis que son frère est dans l’armée canadienne. Jim Carswell est diplômé du Collège militaire royal et il est artilleur. Après la guerre, Jim a travaillé dans le programme spatial américain (Nike, Titan, Mercury, Apollo et la navette spatiale) où sa spécialité consistait à analyser les trajectoires. Photo : Archives de la famille Carswell
Par une journée ensoleillée en Angleterre, probablement lors de leur cours de conversion au Lancaster, Andrew Carswell (à droite) et un membre d’équipage posent auprès d’un Lancaster. Nous supposons qu’il s’agit bien du cours de conversion, car Carswell n’a effectué que quatre sorties opérationnelles avant d’être abattu à la mi-janvier. Le temps sur cette photo semble décidément chaud et peut-être automnal. Photo : Archives de la famille Carswell
Un Lancaster du 9e escadron décolle d'Angleterre. Photo : Musée impérial de la guerre
Janvier 1943 a marqué une période difficile pour le Bomber Command. À chaque fois que l’ennemi mettait au point une nouvelle arme ou apportait une amélioration à sa défense aérienne, nous perdions des bombardiers. Lorsque la RAF ripostait avec une technique avancée comme le « G », nous perdions moins d’appareils. Il s’agissait d’un dispositif de radionavigation qui permettait à nos forces de naviguer par mauvais temps pour trouver la cible et de la bombarder à travers les nuages. En revanche, l’ennemi nous rendait la monnaie avec un tout autre nouveau dispositif, comme les projecteurs dirigés par radar causant ainsi la perte d’un plus grand nombre de nos équipages. C’était comme une partie d’échecs, jouée par des généraux, des maréchaux de l’air et des politiciens. Nous étions des pions sacrificiels.
Le 17 janvier 1943 était une de ces nuits où les Allemands semblaient avoir toutes les cartes en main, y compris la météo. Ils nous attendaient tout au long du trajet. Notre itinéraire partait d’un point situé sur la côte est de l’Angleterre, traversait la mer du Nord jusqu’au Danemark, avec ses lourdes batteries de DCA allemandes, puis traversait la mer Baltique jusqu’à un point situé plus ou moins au nord de Berlin. Là, nous devions tourner vers le sud et survoler directement Berlin, où la force Pathfinder (équipe d’éclaireurs) devait avoir déposé toutes sortes de fusées éclairantes y compris six ou sept mille livres d’explosifs puissants et des bombes incendiaires sur un repère donné.
Les historiens se rendront compte plus tard que la plupart de ces bombes n’ont jamais atteint une cible précise. Cependant, lorsque vous lâchez des dizaines de milliers de livres d’explosifs puissants au milieu d’une grande ville, il y a forcément de très gros dégâts, en particulier au sein de la population civile.
J’avais entendu des histoires d’équipages d’avions britanniques qui, lorsqu’ils avaient été arrêtés par les citoyens allemands en colère après un raid aérien particulièrement intense, avaient été pendus sur place. J’ai entendu des histoires similaires sur des équipages allemands infortunés, arrivant en parachute dans l’est de Londres après un raid particulièrement sanglant, qui ont été abattus par la population locale. Ces histoires sont peut-être apocryphes, mais compte tenu des circonstances, je pense que pour certaines d’entre elles, il y avait plus de vérité que de fiction.
Vue aérienne du quartier Schöneweide de Berlin, près du canal de la Landwehr, les 16 et 17 janvier 1943, la nuit de l’attaque. Les taches blanches indiquent l’emplacement des canons antiaériens lourds. Photo : C 5713 / Royal Air Force Bomber Command, 1942-45 / Imperial War Museum
Cette même banlieue de Schöneweide à Berlin aujourd’hui. Il est ironique de constater que Johannisthal (coin supérieur gauche) a été le site du premier aérodrome en Allemagne qui a ouvert ses portes le 26 septembre 1909, quelques semaines seulement après la construction du premier aérodrome au monde à Reims, en France. Photo via GoogleMaps
J'étais donc là, dans un avion qui plongeait presque à pic, près d'une ville appelée Magdeburg, non loin de Berlin. Le moteur intérieur tribord était engouffré par des flammes qui s’attaquaient maintenant à l’aile. J'ai tiré de toutes mes forces sur le manche, mais il ne répondait pas. J’ai réglé le compensateur de profondeur au maximum et j'ai essayé de paraître plus calme que je ne l'étais en réalité.
« Jock » Martin, mon ingénieur de bord écossais, se comportait lui aussi de manière plutôt cool. Il récupéra méthodiquement le parachute ventral de chaque membre d’équipage de l’étagère situé à tribord. À l’aide de la lumière orange vacillante de l'incendie, il lisait les noms des membres et les distribuait au navigateur, au bombardier, à l'opérateur radio et à moi. Vu la façon négligente dont certains d'entre nous ont traité nos parachutes dans la salle d'équipage, je pense qu'il voulait s'assurer d'avoir le sien.
J’avais réussi à remonter le nez de mon avion gravement endommagé et en feu pour arriver à un piqué moins raide et j’ai ensuite donné l’ordre de « sauter », sur un ton que j’espérais assez professionnel. Malgré la mise en marche de l’extincteur interne du moteur, le feu engouffrant le moteur intérieur tribord refusait de s’éteindre. Encore pire, il se propageait rapidement vers les réservoirs de carburant principaux contenant au moins des centaines de gallons d’essence d’aviation à haut indice d’octane. En quelques secondes, les réservoirs de carburant exploseraient !
Paddy Hipson, notre bombardier irlandais, a tiré la goupille de largage de la trappe d’évacuation avant. Immédiatement, le coussin sur lequel il était couché quelques minutes auparavant, ainsi que la trappe, ont été arrachés vers le bas et engloutis dans l’obscurité rugissante. Le vacarme des trois moteurs Rolls-Royce Merlin de 1250 chevaux toujours en marche envahissait le cockpit avant du Lancaster et hurlait au-dessus du rugissement du vent. En même temps, les papiers, des cartes et des débris divers étaient aspirés dans le vide obscur. Paddy a hésité, puis d’un pas vers le trou noir, a disparu.
Jock Martin a soigneusement replié son strapontin immédiatement à ma droite, permettant ainsi l’accès au compartiment avant, et s’est avancé. Sans hésitation, il a plongé la tête la première dans l’ouverture, serrant son parachute ventral des deux mains. Notre opérateur radio et mitrailleur anglais, Eddie Phillips, l’a suivi peu de temps après, sans même donner un signe de tête dans ma direction. J’étais heureux de les voir sortir si vite, car l’avion semblait sur le point d’exploser. Les flammes vives dévoraient toujours l’aile, à quelques centimètres seulement des réservoirs de carburant.
L’ingénieur de bord d’un Avro Lancaster se retourne pour actionner un interrupteur sur le tableau de bord pendant le vol. Il est assis sur un strapontin rabattable. C’est ce même siège que Jock Martin a replié afin de permettre aux autres membres de l’équipage d’accéder à la trappe d’évacuation avant. Photo : Imperial War Museum
Une vue vers l’avant depuis le poste d’Eddy Philips (l’opérateur radio de Carswell) montre l’espace extrêmement étroit réservé aux membres de l’équipage. Le siège faisant face à la gauche était le poste de navigateur de John Galbraith. Lui et Andrew Carswell ont été les derniers à quitter l’avion. Cette illustration et les suivantes sont une gracieuseté de Piotr Forkasiewitcz, un artiste numérique polonais aux capacités prodigieuses. Pour voir d’autres de ses œuvres exceptionnelles, lisez Une beauté terrifiante ou visitez son site Web étonnant à l’adresse peterfor.com
La position du pilote dans l’Avro Lancaster. Pour évacuer l’appareil, l’équipage devait s’accrocher à la main courante jaune, descendre dans le compartiment du bombardier et plonger par la trappe ouverte. Illustration par Piotr Forkasiewicz
On aperçoit dans cette photo la trappe d’évacuation par parachute situé à la position du bombardier dans le nez de l’avion. C’était la responsabilité du bombardier de Carswell, Paddy Hipson, de tirer sur l’anneau de largage pour ouvrir la trappe. Cette trappe de secours était réservée pour tous les membres de l’équipage situés à l’avant de l’appareil. Pour finalement s’échapper dans l’obscurité, ils devaient s’y rendre encombrés par leur équipement et leur parachute dans un avion qui basculait vers le sol en piqué incontrôlable. Illustration par Piotr Forkasiewicz
Soudainement, la voix tendue provenant de la tourelle supérieure se fit entendre sur l’interphone — Joe de Silva, un Anglais, plus âgé que nous tous, marié et père de famille — « Je suis coincé ! Je ne peux pas sortir ! »
Puis la voix de Claude Clemens, notre mitrailleur arrière canadien : « Tiens bon, Joe ! Je vais le sortir de là ! ». Après une longue pause, la voix de Clem retentit à nouveau : « Il va bien maintenant, Patron - il est sorti de l’appareil maintenant, et je le suis ». Puis silence sur l'interphone.
Nous étions maintenant sous dix mille pieds, et l'aiguille de l'altimètre tournait à une vitesse alarmante. Le bruit et le vent envahissaient le cockpit. Retenir le manche prenait toutes mes forces. L'indicateur de vitesse dépassait la ligne rouge et le bruit provenant de l'écoutille ouverte était assourdissant. Même si les quatre manettes de gaz étaient réglées au ralenti, les hélices s’emballaient. Nous n'étions plus que deux, John Galbraith, notre navigateur canadien, et moi.
L’interphone de John était débranché, le cordon pendait de son casque de vol en cuir. J’ai attrapé son épaule, je l’ai tiré vers moi et je lui ai crié à l’oreille : « Sors de là, espèce d’abruti ! ».
Il m’a regardé avec une expression étrange sur le visage et a crié par-dessus le bruit : « On peut ramener l’appareil à la maison ! ».
J’ai attrapé le fil qui pendait sur son casque, je m’en suis servi pour tirer sa tête vers la mienne et je lui ai crié à l’oreille : « Regarde ce feu, espèce d’idiot ! On va exploser d’une seconde à l’autre et tu restes là à discuter ! Fous le camp ! Les commandes sont foutues et je ne peux pas tenir plus longtemps ! Si tu ne sors pas, je pars quand même ! »
« Prends un cap de deux sept zéro, plein ouest, » m’a-t-il crié à l’oreille, « et on se tire d’ici. »
« Ne fais pas l’idiot ! » J’ai crié. « On se dirige directement vers le sol ! » Nous étions maintenant à environ 7000 pieds.
Il se tenait là, son parachute ventral déjà accroché, et me regardait avec un regard étrangement sauvage que je n’avais jamais vu auparavant. Mon parachute était toujours sur mes genoux, là où Jock l’avait laissé tomber. J’ai lâché le manche, ramassé le parachute, et l’ai attaché à mon harnais de poitrine.
« Dégage, alors ! » J’ai crié et je l’ai poussé. J’ai attrapé son col et rapproché son visage du mien. « Tu ferais mieux de me suivre maintenant — il te reste environ dix secondes ! »
Il m’a fixé avec des yeux sauvages. Puis j’ai plongé par l’écoutille ouverte dans le trou noir rugissant, serrant mon parachute contre ma poitrine.
Dans toutes les histoires d’héroïsme dans le domaine de l’aviation que j’avais lues, le capitaine était toujours le dernier à quitter son avion, même s’il n’était que sergent pilote. Et j’étais l’avant-dernier à quitter mon appareil ! Je n’avais pas le temps d’argumenter avec John. Je savais que dans quelques secondes nous allions exploser en l’air, ou nous écraser au sol. J’espérais qu’il allait se rendre à la raison si je mettais fin à la discussion en plongeant avant lui. J’avais une autre motivation forte : je ne voulais pas mourir !
James Cagney ou d’autres héros de cinéma de l’époque auraient probablement assommé John d’un coup de poing à la mâchoire et l’auraient porté avec lui en évacuant l’avion en flammes. J’avoue que je ne partage pas cette trempe héroïque.
On a découvert plus tard qu’il n’était pas dans l’avion quand il a heurté le sol et explosé. Je me suis dit que je ne reverrais plus jamais ma montre Rolex Oyster que John portait cette nuit-là. Mon père me l’avait offerte pour mon dix-huitième anniversaire. Elle portait mon nom, mon numéro de matricule et la date de mon premier vol en solo. Je l’avais prêtée à John cette nuit-là. L’escadron avait perdu tellement d’équipages au cours des derniers mois que la section d’approvisionnement n’avait plus de montres de navigation standard. John, qui avait besoin d’une bonne montre pour naviguer, avait emprunté la mienne. Elle était en sa possession lorsqu’il a sorti par la trappe de secours — s’il est sorti.
Je n’avais jamais sauté en parachute. À cette époque, les parachutistes passaient des mois à s’entraîner pour leurs sauts, sautaient rarement la nuit et ne sautaient jamais lorsque le vent était fort. Ce saut, mon premier, dernier et unique saut, s’est déroulé de nuit, avec un vent de surface glacial d’environ 40 milles à l’heure en provenance de l’ouest, et des températures de moins 20 degrés Fahrenheit. Lorsque l’avion était à vingt mille pieds, le vent soufflait à près de cent milles à l’heure. Pas étonnant que nous ayons dévié de notre route et que nous ayons survolé Magdebourg au lieu de Berlin.
Illuminé par la lumière vive de la lune, je pouvais distinguer les champs, les bois, quelques petits villages et une rivière. D’après mes estimations, j’allais probablement passer au-dessus des bois et atterrir un peu au-delà de la rivière. J’espérais toujours éviter la rivière quand, avec un fracas, j’ai chuté à travers la cime des arbres, presque au centre de la forêt. C’est arrivé si vite que je n’ai pas eu le temps de m’y préparer. Je dérivais rapidement au-dessus des bois qui me semblaient être à des milliers de pieds sous mes pieds. Mais dans un instant, je me suis retrouvé suspendu au-dessus du sol, mon parachute accroché aux branches supérieures d’un grand pin.
Après le bruit du fracas et des branches qui se brisent, il y a eu un silence aussi soudain qu’étrange. Je me suis retrouvé à me balancer doucement et sans défense à quelques centimètres du tronc d’un arbre, à vingt pieds du sol. L’impact m’avait coupé le souffle.
Je suis resté suspendu, persuadé que la moitié de l’Allemagne avait entendu le vacarme et me poursuivait. Au fil des minutes, le silence était assourdissant. Je pouvais entendre mon pouls retentir dans mes tympans. De plus, j’ai conclu que je ne pouvais pas être mort, car je commençais à sentir le froid et finalement, mon entrejambe me faisait mal !
Quand j’étais un petit garçon dans le quartier de Beach à Toronto, je grimpais régulièrement aux arbres. J’avais déjà escaladé quelques ormes et châtaigniers du quartier s’élevant jusqu’à 60 pieds. C’est cette compétence qui a maintenant porté ses fruits. Je me suis balancé pour m’accrocher au tronc de l’arbre. J’ai ensuite grimpé d’un pied ou deux pour relâcher la tension des cordes sur le harnais de mon parachute avant d’enfoncer la boucle de raccord à largage rapide situé au niveau de mon ventre.
Mon harnais s’est dégagé et j’ai glissé prudemment vers le sol, laissant mon parachute et mon harnais pendre de la cime des arbres. Je me suis alors assis sur une grosse racine à la base du pin, j’ai allumé une cigarette et j’ai essayé de faire le point sur ma situation.
J’avais l’impression d’être au cœur d’une forêt de pins. Les arbres étaient serrés les uns contre les autres et s’élevaient très haut. Dans les clairières, la lune éclairait la neige profonde et se reflétait dans les bois tout autour de moi, projetant des lueurs fantomatiques. La pleine lune brillait et les étoiles semblaient plus brillantes que d’habitude. Je ne ressentais pas de vent dans la forêt, même si je pouvais voir la cime des arbres au-dessus de moi se balancer. C’était très silencieux et extrêmement froid.
J'ai commencé à regretter ma décision de ne pas avoir porté tous les éléments de ma combinaison Irving. Même si je portais la veste et les bottes en peau de mouton, je n'avais pas pris la peine de mettre le lourd pantalon également doublé en peau de mouton. Ce pantalon entravait l’efficacité du mouvement de mes jambes et de mes pieds sur les pédales du gouvernail, surtout à l'atterrissage. J’étais vaniteux quant à mes prouesses à l’atterrissage et je m’efforçais de toujours poser mon appareil pesant 65 000 livres « doucement » et surtout sans le faire rebondir sur la piste. En cet instant, réaliser un atterrissage en douceur sur les trois roues ensemble ne semblait pas très important.
J’avais arraché mon casque en cuir, mes écouteurs et mon masque à oxygène au moment de ma sortie par la trappe d’évacuation avant. J’avais donc la tête nue. Je me félicitais de ne pas avoir pu me faire couper les cheveux au cours des trois dernières semaines, car l’épaisseur de ma chevelure brune me tenait maintenant raisonnablement chaud. J’ai remonté le col en fourrure de mon blouson d’aviateur autour de ma tête et j’ai réchauffé mes oreilles avec mes mains. Mes gants de cuir fins, fournis par la RAF, étaient doublés de soie ou de nylon. Ils étaient parfaits pour actionner les interrupteurs du cockpit et pousser les manettes des gaz, mais pas vraiment conçus pour la randonnée hivernale.
J’ai examiné ma trousse de survie et d’évasion. Il s’agit d’une trousse standard pour tous les équipages : quelques barres de chocolat et des pilules, un très grand canif, un ouvre-bouteille et un ouvre-boîte, une boussole, une lame de scie à métaux, des bonbons durs, des rations d’urgence, une grande carte d’Europe en soie et de l’argent français et néerlandais. J’ai retiré ma botte de vol droite et l’une de mes deux paires de chaussettes en laine, puis j’ai soigneusement plié la carte en soie et l’ai placée de manière à ce qu’elle se trouve entre les deux couches de chaussettes. J’ai placé la lame de scie à métaux qui peut aussi servir de boussole entre les deux chaussettes de mon pied gauche. La lame de scie à métaux de deux pouces était magnétisée ; pour l’utiliser comme boussole, il fallait la suspendre par un fil attaché au trou situé au milieu de la lame. De cette façon, l’extrémité tranchante pointait vers le nord. Il y avait une pilule « wakey-wakey[1] » pour rester alerte en cas d’urgence. Cela semblait être une urgence. Je n’étais pas particulièrement endormi, mais j’ai quand même avalé la pilule.
J'ai terminé la barre de chocolat, remis le reste de ma trousse de survie et d’évasion dans diverses poches de mon uniforme, et suis arrivé au milieu d'une clairière. La majorité de la constellation boréale, y compris la Grande Ourse et l'étoile Polaire, était au rendez-vous comme elle devait l’être. Je n'étais probablement pas la seule personne à fixer l'étoile Polaire cette nuit-là, mais je suis certain que peu d'autres personnes auraient pu se sentir aussi seules et en danger que moi.
Au loin, je pouvais distinguer très faiblement le son d’une sirène de raid aérien qui sonnait la fin de l’alerte. C’est à ce moment que j’ai commencé à prendre conscience de la réalité de ma situation. Il ne s’agissait pas d’une scène de film hollywoodien, où le héros tombe miraculeusement sur un aérodrome de Me 109, trompe tous les nazis avec son déguisement et sa maîtrise parfaite de l’allemand. Par la suite, il saute dans un Messerschmitt qui l’attend — le moteur en marche et suffisamment de carburant pour se rendre en Angleterre — et s’envole vers les bras de sa petite amie, tout en abattant quelques escadrons ennemis en chemin.
Maintenant c’était la réalité ! Je n’étais qu’un pilote adolescent avec tout juste quelques centaines d'heures de vol, aucune connaissance de la langue allemande et une connaissance très élémentaire de la géographie européenne. Pour enchérir, je ne pouvais pas faire appel à un talent particulier si ce n'est la capacité de courir, grimper, nager, camper, pagayer un canoë, et piloter un bombardier quadrimoteur, coincé au beau milieu de l’Allemagne !
« Si le nord est par là, alors le sud-ouest est par là », ai-je pensé, en m’alignant dans la bonne direction et en me dirigeant à peu près dans une direction sud-ouest. Je savais que la Hollande se trouvait dans cette direction, à environ 400 miles. Autrement que de rester assis là où j’étais, et il faisait bien trop froid pour cela, je ne voyais rien de mieux à faire. Je devais marcher, ou mourir de froid.
Le grand col en peau de mouton de mon blouson, une fois relevé, couvrait presque mes oreilles, et j’ai remercié les fournisseurs d’avoir été si prévoyants. Les mains enfoncées dans les poches de la veste, je me frayais péniblement un passage dans la neige profonde de la forêt silencieuse, tout en essayant de maintenir mon cap.
Le brillant clair de lune illuminait les petites clairières, cet éclairage reflété faisait ressortir chaque arbre et chaque buisson sinistrement. Le seul bruit était celui de la neige fraîche qui craquait sous mes bottes.
Je suis tombé sur une route que j’ai traversée à angle droit pour ensuite pénétrer à nouveau dans la forêt. J’ai aussi traversé de nombreux champs déserts et bon nombre de ruisseaux gelés. En essayant de sauter un petit ruisseau, la glace a cédé et mon pied a calé jusqu’au genou. Je pouvais sentir l’eau froide s’infiltrer à l’intérieur de ma botte. Je l’ai retiré pour vider l’eau et je me suis rechaussé. Mes mains se sont engourdies par cette petite opération, et les orteils de mon pied mouillé perdaient leur sensibilité.
Rester en mouvement semblait être le seul moyen de résister au froid, alors j’ai continué à marcher. Ma montre indiquait qu’il était deux heures du matin. Il ne semblait pas possible que j’aie marché pendant plus de quatre heures. Je n’étais ni endormi ni fatigué probablement à cause de la pilule que j’avais prise dans ma trousse de survie. Dieu seul sait quelle drogue puissante elle contenait. Je l’ignorais, car je n’avais jamais pris quelque chose de plus fort que de l’aspirine.
Le reste de la nuit m’a réservé une horreur glaciale, à tituber et à me traîner dans les bois et les champs vides. Je n’ai rencontré aucun résistant français, Hollandais ou Norvégien pour m’évacuer clandestinement du pays.
En toute vérité, j’étais un sergent pilote sans importance et remplaçable qui se trouvait perdu plus ou moins au centre de l’Allemagne. Je n’avais aucune idée, comment m’en sortir. Non seulement ça, mais encore, je venais tout juste de tenter de larguer plusieurs milliers de livres d’explosifs sur sa capitale, un fait qui pouvait énerver certains des citoyens les plus nerveux.
Ces pensées me traversaient l’esprit alors que je me traînais à travers les fossés, les clôtures, les champs et les bois, tombant régulièrement et balayant la neige de mon corps inconsciemment. Le ciel s’éclaircissait à l’est derrière moi lorsque je suis tombé pour la dernière fois dans un champ juste à côté de ce qui semblait être une route assez bien fréquentée.
Je me suis relevé, j’ai regardé mes jambes incrustées de glace et mes pieds à moitié gelés, j’ai replacé mes mains engourdies dans les poches de mon blouson et je me suis dirigé vers la route. Une logique de survie élémentaire a pris le dessus.
Je pourrais me cacher dans les bois, et les Allemands ne me trouveraient jamais, pas avant le printemps, en tout cas. Et tout ce qu’ils trouveraient alors serait probablement un cadavre à moitié pourri, grignoté par des animaux sauvages. Ou je pourrais marcher le long de la route, et quelqu’un me capturerait et m’enfermerait dans une prison bien chauffée ! Le soleil commençait à se lever. J’avais marché pendant sept ou huit heures et il était maintenant cinq ou six heures du matin. J’avais mangé tout mon chocolat, mes bonbons, mes pilules et tout ce qui était comestible dans ma trousse de survie.
Ma décision prise, j’ai marché effrontément sur la route de campagne déserte, m’attendant à tout moment à entendre le bruit d’un véhicule militaire se dirigeant vers moi. Mais rien. J’aurais tout aussi bien pu marcher sur la lune. Au loin, à environ un quart de mile de la route, je pouvais voir qu’il s’y trouvait une intersection. La route de gauche semblait mener à un petit village.
Arrivé au carrefour, je me suis arrêté, et scrutais le village. À quelques centaines de mètres sur la route, sur la droite, se trouvait une petite maison à deux étages, avec une courte allée de l’autre côté et une sorte de dépendance derrière. Un chien aboyait au loin. Il n’y avait aucun autre signe de vie. Je me suis dirigé vers la maison.
Même aujourd’hui, soixante ans plus tard et beaucoup plus intelligent, je n’arrive toujours pas à imaginer quelle autre option j’aurais pu choisir, à part mourir de froid dans les bois. Pourtant, je me sentais coupable de m’être rendu au premier Allemand venu, surtout après la mon altercation avec John Galbraith. J’y ai pensé toute la nuit en me démenant dans la neige, et j’ai espéré et prié pour qu’il ait réussi à sortir par la sortie de secours. Il aurait eu largement le temps, car l’avion avait amorcé une descente en pente faible et n’avait pas explosé avant de s’écraser un bon moment après l’ouverture de mon parachute.
Andrew Carswell
Le sergent Andrew Carswell (au dernier rang, quatrième à partir de la droite) pose avec ses codétenus dans un camp de prisonniers de guerre allemand. Les chapitres suivants de Over the Wire brossent ensemble une image puissante et émotionnellement épuisante de la défiance. Photo : Collection de la famille Carswell
Aperçu d’une page du journal des opérations du 9e Escadron concernant les équipages partis en mission le 17 janvier. On y voit que Carswell pilotait le Lancaster W4379 et qu’il a décollé à 16 h 54, mais n’est pas revenu. Photo : 9 Squadron ORB
Pour déterminer le code avion du Lancaster W4379, nous vous invitons à consulter les pages de journal des opérations de la nuit précédente (16 janvier) au cours de laquelle il a également piloté le W4379. La page sommaire indique qu'il s'agissait de l'avion « A ». Photo : ORB du 9e escadron
Andrew Carswell lors des cérémonies du jour du Souvenir au Canadian Warplane Heritage Museum en 2014. La cérémonie a eu lieu avec le Lancaster à l’intérieur du hangar. Chacun des sept postes d’équipage a été honoré par la présence d’un vétéran du Bomber Command de la Seconde Guerre mondiale occupant ce poste. Andrew Carswell représentait le rôle du pilote dans l’équipe du Lancaster. Il porte son épingle de cravate d’évadé, son épingle de ver en soie de parachute Irving, son agrafe Bomber Command et sa cravate de personnel navigant. Il n’a pas été décoré de l’étoile d’Europe de l’équipage aérien, car il aurait fallu à son actif des vols opérationnels pendant deux mois pour la mériter... mais il a été abattu lors de sa quatrième opération. Il porte également la Croix de l’Armée de l’Air pour le service en temps de paix. Andrew Carswell a poursuivi sa carrière de pilote en temps de paix au sein de l’ARC en pilotant, entre autres, l’hydravion Canso dans le cadre de missions de sauvetage aérien et maritime en haute mer. Photo : John Carswell